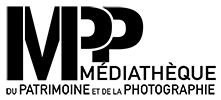Les actualités de la MAP viennent à vous
Découvrez les collections de la MAP depuis chez
Les objets
visite guidée
FERNAND BALDET, MOULIN DE LA FOLIE
En 1932, sans doute à l'occasion d'une excursion scientifique à la mode à cette époque, Fernand Baldet visite Maintenon et Saint-Piat. Ce cliché donne l'occasion de voir le moulin de la Folie que je connais à travers les récits des « anciens » du village, mais que je n'aurai jamais l'occasion d'admirer. Et pour cause ! Si l'Eure entre ces deux villes compte plusieurs moulins du même type, celui-là est le seul dont il ne reste aucune trace. Ce moulin avait été bâti en 1836 sur le domaine dit de la Folie, qui dépendait du château de Maintenon. Pourquoi Folie ? Sans doute, comme le suggère Littré, parce que cela vient de « feuille ; feuillée », plus largement « abri de feuillage ». Le terme désigne, à partir du 14e siècle, les maisons de campagne que se bâtissent aristocratie et bourgeoisie à l'orée des zones urbaines. Le domaine se compose aujourd'hui d'une ferme, d'un haras et des restes d'un manoir. Le moulin de la Folie connaît un boom d'activité jusqu'en 1897, puis périclite. Située à moins d'un kilomètre du grand moulin de l'Orme-Halé, le seul encore actif aujourd'hui, sa chute d'eau devient insuffisante pour actionner la roue. En 1903, une laiterie y est installée par l'entreprise Maggi. Elle alimentait chaque jour Paris en lait frais et stérilisé. Malheureusement, la seconde guerre mondiale éclate. Les Allemands s'installent un peu partout alentours. A Saint-Piat, un casernement occupe l'actuelle bibliothèque municipale. Au domaine de Grogneul, sur les hauteurs du village, avec vue imprenable sur la vallée de l'Eure, un casernement est bâti dans le parc et une batterie anti-aérienne est placée au sommet du grand cèdre étêté à cet effet. Le domaine de la Folie, en limite de Maintenon et Saint-Piat, n'échappe pas aux Allemands. Un casernement y est également installé. Des stocks importants de munitions sont cachés dans les prés, sous des bâches imitant des vaches ! Cependant, la ruse ne trompe pas les Alliés qui, en mai 1944, bombardent les lieux. L'explosion de la réserve de munitions est telle qu'elle souffle tous les vitraux médiévaux de l'église Saint-Piat, située à deux kilomètres. Au cœur de la déflagration, le moulin et le manoir ne résistent pas. Si le manoir est retapé, le moulin, lui, est conservé à l'état de ruines jusqu'à sa démolition totale en 1958. Fatima de Castro, avril 2020

visite guidée
Émile Muller
Émile Muller fut un témoin engagé des années 1950 et 1960
Découvrez les photos de Emile Muller sur POP Né le 18 avril 1912 à Paris, Émile Muller suit tout d’abord une formation de mécanicien-ajusteur. Membre du parti communiste, il s’installe comme photographe à partir de 1935 dans le quartier de Montparnasse. Le mécanicien photographe devient rapidement un membre actif du parti communiste. Installé au 7 rue Froidevaux dans le 14e arrondissement, il rencontre de nombreux photographes comme Robert Capa, André Kertész et Man Ray. Prisonnier de guerre en 1940, il s’évade et entre dans la clandestinité à son retour sur Paris. Faussaire, le militant cache des communistes allemands et tchèques pendant l’Occupation. Après guerre, Émile Muller lance véritablement sa carrière de photographe. Réservant la chambre 4 x 5 inches à certaines commandes de la presse, il adopte le Rolleiflex et le Leica, plus maniables. Son épouse crée une petite agence, « Photo de presse Catherine », pour diffuser ses reportages et des images de ses amis, comme Émeric Feher ou Robert Doisneau. En 1946, il devient correspondant à Paris pour le quotidien l’Algemeen Handelsblad et travaille pour les Nations-Unies. Il photographie la population en proie au rationnement, les mouvements de grèves. Il est aussi autorisé à photographier les prisonniers de guerre allemands à Hesdin, Barlin, Douai, Lens ou Dunkerque. Ses reportages montrent les cours sordides des corons, les cités de transit, les grèves ou l’enterrement des mineurs. La presse de gauche le découvre : il est engagé par l’hebdomadaire Action en 1951 et le quotidien Ce soir en 1952. Regards publie ses photographies de camarades et compagnons de route du parti communiste : Picasso au Congrès de la Paix, Gérard Philipe aux assises des mal logés, l’enterrement d’Éluard et Yves Montand au comité d’entreprise de Renault. Témoin engagé, il saisit pour la presse communiste les grands événements parisiens et rendez-vous annuels qui marquent la vie du mouvement : fête de L'Humanité, défilés du premier mai, anniversaires de Thorez, de la révolution d’octobre, mais aussi les célébrations de la mort de Staline par le quotidien L’Humanité, dont l’immeuble rue du Louvre est ceint d’un crêpe noir. À partir de 1958, il devient, à la demande d’Aragon, photographe salarié des Lettres françaises. Pendant une décennie, il couvre les ateliers d’artistes, les manifestations culturelles, les expositions : salon d’automne, salon de mai, salon des « grands et jeunes d’aujourd’hui », comité national des écrivains, bataille du livre. Dans ses images, il est possible de croiser Trénet, Camus, Piaf, Yves Robert ou le cirque Amar. Le fonds Émile Muller, acquis par la MPP en 2017, se compose : des archives produites tant dans le cadre de ses activités professionnelles que de sa vie familiale (1 mètre linéaire): correspondances, documents officiels, compte-rendus de reportages, 15 000 négatifs sur support souple 2000 tirages. Les procès Émile Muller profite des quelques années où les reporters-photographes sont autorisés à suivre les audiences pour assister et rendre compte de quelques procès qui ont défrayé la chronique, notamment celui de Marie Besnard et celui d’Henri Martin. Les mines du Nord Émile Muller est aussi le témoin des conditions de vie, de travail et des drames des mineurs dans l’immédiat après-guerre. La vie du parti communiste français Il est aussi l’un des photographe des grands moments de la vie du parti communiste français de l’après-guerre et photographie les célébrations autour de la mort de Staline et les fêtes de L’Humanité. Il est aussi le chroniqueur de la vie culturelle parisienne des années 1950, comme en témoignent ces photographies de: Charles Trénet, Albert Camus, Yves Montand, La Comédie français. Matthieu Rivallin, avril 2020
#Culturecheznous
Willy Ronis, La chaussure nationale, usine Pillot, Paris, 1946. © Donation Willy Ronis, ministère de la culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion GrandPalaisRmn Photo
Commande du périodique La Française, Paris, 1946
Au sortir de la seconde guerre mondiale et en réponse aux crises d’approvisionnement qui perdurent, l’État encadre la production de biens de première nécessité. Ces mesures reprennent de précédentes décisions prises lors de la première guerre mondiale par Étienne Clémentel, ministre de l’Économie et de l’Industrie. « La chaussure nationale » dite les « clémentelles », « le costume national », autant de de productions accompagnées afin de répondre aux fortes tensions entre un tissu industriel désorganisé et l’assouvissement de besoins primaires. Ces nécessités « populaires » ne sont certes pas vitales, leur réponse permet d’assurer un relatif équilibre social. Par son intervention économique, l’État organise la production industrielle et la rationalise. Comme toujours lors de pareils cas, les mots clés sont réappropriation de l’industrie nationale, production de masse, diffusion et prix raisonnables – le président Macron parle de solidarité et de souveraineté. Situation que nous ne connaissons pas aujourd’hui – ou pas encore –, l’inflation alourdit alors considérablement la vie : d’août 1944 à décembre 1947, les prix sont multipliés par 4,5 soit une progression moyenne de + 56 % par an ! L’État assure les équilibres. Après des années difficiles durant la guerre sur le littoral méditerranéen, Willy Ronis reprend en 1945 son métier de photographe indépendant. Illustrateur-reporter, il répond ici à une commande du périodique La Française, le journal de progrès féminin. La société Pillot est localisée au 126 boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement ; Willy Ronis habite chez sa mère au 117 boulevard Richard-Lenoir, c’est donc en voisin qu’il se rend dans cette très petite industrie urbaine. L’ouvrière occupe pleinement le cadre, tout autant que son outil de fabrication et le produit manufacturé. Deux autres ouvrières en arrière-plan suggèrent des locaux de petite dimension éclairés à la lumière naturelle. Chez Ronis, les années 1945-1954 – date de son départ de l’agence Rapho – sont « humanistes », qualificatif tardivement accolé à la photographie de Willy Ronis. Il travaille pour la presse engagée de gauche et se tisse un réseau rémunérateur de clients industriels, particulièrement en Alsace. La France se redresse ; les Français sont acteurs du redressement. À partir de la fin des années 1950, les photographies industrielles de Willy Ronis se déshumanisent. La mécanisation, l’automatisation, le rendement à moindre personnel s’accompagnent chez lui d’une photographie appliquée et technique, d’effets de laboratoire surprenants et passés de mode. En 1950, il défend pourtant ses convictions professionnelles à l’entreprise de constructions mécaniques Crétin : « Je m’attache à inclure dans mes prises de vues le caractère humain que recèle tout travail, même le plus hautement mécanisé, et cela par le choix du geste et de l’attitude [...], par un souci de vie ». Lors de sa consécration à partir des années 1980, Willy Ronis ressassera à l’envi son intérêt pour l’homme et pour la vie, sélectionnant dans ses archives les photographies qui répondent à cette attente, comme celle-ci, pour le livre de Gilles Mora et l’exposition qui l’accompagne, Le Dur labeur, Arles, Actes Sud, 2007. Ronan Guinée, avril 2020.

#Culturecheznous
Accident de chemin de fer, 24 septembre 1905
Auguste Brutails, Saint-Macaire, Viaduc, septembre 1905
Si les fonds conservés par la MAP n’ont pas fini de nous surprendre, l’inattendu surgit parfois au détour des chemins les mieux balisés. Prenez le fonds des Monuments historiques, par exemple, noyau dur de nos collections, tout entier centré sur l’architecture et le patrimoine ; et, dans ce fonds, l’ensemble produit par Auguste Brutails (1859-1929) : ce sont 1649 négatifs en ligne consacrés aux monuments du sud-ouest, dont il fut l’un des grands connaisseurs, et plus particulièrement aux églises de la Gironde, sujet de sa thèse de doctorat. Médiéviste et archéologue, diplômé de l’École des chartes, il s’est également fait photographe pour mieux nourrir ses travaux de recherches. Et voilà qu’au milieu des ensembles aux cadrages élégants, des nefs et chapelles, des vues de détail, des objets, le registre 16 inscrit cet article insolite : N°100819, Saint-Macaire, Viaduc, accident de chemin de fer [s.d.] Le laconisme de l’inventaire sert admirablement le spectaculaire de la photographie. On se retrouve témoin sans s’y attendre, comme on imagine que cela a pu se produire pour Auguste Brutails. Était-il en tournée à ce moment-là, présent par le plus grand des hasards, venu avec le flot des curieux ou appelé sur les lieux pour ses compétences de photographe ? On découvre la scène avec lui, le contraste entre les machines fracassées et la tranquillité du paysage, la pose des badauds au premier plan – calme, ou sidération peut-être. C’est qu’il y a eu trois morts, le mécanicien, le chauffeur et un garde-frein... On le sait par Le Figaro du lendemain, dans la rubrique « Nouvelles diverses dans les départements » : l’accident survient entre 2 et 3 heures du matin, le 24 septembre 1905 ; sur la ligne Bordeaux-Montauban, en gare de Langon, trente-deux wagons du train de marchandises 1104 partent en dérive après une rupture d’attelage et viennent heurter, à Saint-Macaire, le train 2122 qui le suit à deux minutes d’intervalles, précipitant sa locomotive en contre-bas. La belle perspective du viaduc justifie pleinement la présence de ce cliché dans le fonds MH, mais ce qui nous parvient encore du fracas de l’événement, après plus d’un siècle, redonne un je-ne-sais-quoi d’actualité à nos vieux fonds patrimoniaux qui ne laisse pas de nous troubler le regard… Anne Cook, avril 2020.

#Culturecheznous
Suzy Delair
Sam Lévin, Suzy Delair et Louis Jouvet sur le tournage de Quai des Orfèvres, 1947
Le 15 mars 2020, Suzy Delair tirait sa révérence. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, après tout, c’est du Paris des années 40 qu’elle fut la star, mais une vie de 102 ans – dont presque 60 de carrière – sous le signe de la Parisienne ascendant chic-canaille, ça mérite un coup de chapeau. Le théâtre, gamine, déjà, elle ne rêve que de ça ; mais fille d’une couturière et d’un sellier-carrossier, il lui faut un métier. Ce sera modiste, dans un premier temps. Qu’à cela ne tienne : adolescente, elle passe le pied dans la porte en enchaînant les figurations au cinéma et au théâtre. C’est toutefois le music-hall qui lui apporte ses premiers engagements, et les premières galères aussi, entre cabarets parisiens et tournées de province. Choriste aux Bouffes-Parisiens en juillet 1938 pour gagner trois sous, elle subjugue un jeune journaliste à l’âme de Pygmalion, auteur de chansons à ses heures perdues. Il se présente à sa loge, l’envoûtement est réciproque, les voilà à la colle. À l’époque, Henri-Georges Clouzot a écrit des scénarios et des adaptations, mais n’a encore rien tourné. Du reste, il ne voit pas forcément sa compagne en actrice, la pousse surtout à continuer les tours de chants, à prendre des cours, à tenter l’opérette. C’est lui, tout de même, qui lui confie ses premiers grands rôles au cinéma : Le Dernier des six (dont il a écrit le scénario), L’assassin habite au 21, et surtout Quai des Orfèvres, en 1947, qui marque l’apogée de sa carrière au cinéma. Le couple se sépare peu après, et Suzy Delair continue à tourner avec les plus grands réalisateurs – Jean Grémillon, Jean Dréville, René Clément, Christian-Jaque, Marcel Lherbier, Claude Autant-Lara, Marcel Carné, Henri Jeanson, Luchino Visconti et Gérard Oury. Elle touche à tous les genres, du drame à la comédie, et à tous les rôles, avec une prédilection peut-être pour les garces et les enquiquineuses… Passées les années 50, les propositions de réalisateurs se faisant plus rares, elle retrouve le théâtre et la chanson – qu’elle n’avait jamais vraiment quittée. Comédienne, mais avant tout chanteuse, sa gouaille et sa spontanéité font oublier sa solide formation lyrique et son travail quotidien. Là encore, elle se frotte à tous les styles : cabaret, music-hall, opérette, où Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault la réclament pour La Vie parisienne. Elle interprète des dizaines de chansons dont un bon nombre de succès, flirte avec le jazz. Au premier Nice Jazz Festival (1948), elle chante « C’est si bon » en présence de Louis Armstrong, conquis, qui l’enregistrera deux ans plus tard. Boris Vian, séduit par sa voix et sa personnalité, lui compose un « Relax » sur mesure, qui colle encore pas mal à l’air du temps… En 2003, elle enregistre encore une anthologie, De l’opérette à la chanson, récompensée par un Orphée d’or de l’Académie du disque lyrique. Suzy Delair a sa place à la MAP parmi les portraits du studio Harcourt, les photographies de plateau de Roger Corbeau et de Sam Lévin. La photo du jour a été prise sur le tournage de Quai des Orfèvres, mais il est peu probable qu’elle apparaisse au montage final... Elle illustre surtout la réjouissante complicité qui unit Louis Jouvet et Suzy Delair, partenaires dans plusieurs films. Anne Cook, avril 2020.

#Culturecheznous
Denise Colomb, Reportage consacré aux cochers et écuries de Paris, 1953 ou 1954
1954, Paris
Denise Colomb, Reportage consacré aux cochers et écuries de Paris, 1953 ou 1954 Le premier étalon que l'on voit dans d'autres photos promener des touristes en calèche dans les beaux-quartiers du VIIIe arrondissement de Paris est ici "confiné" dans son box à l'écurie de l'entreprise familiale. Donc, après une dure journée de labeur, tête hors du box, il attend sa récompense, une friandise, qu'il regarde avec gourmandise tout en tirant la langue. Cette posture lui donne, un air à la fois espièglement moqueur et tendrement soumis. Au milieu du 20e siècle, les chevaux de calèches étaient, semble t-il, en voie de disparition et avaient déjà largement laissé la place aux deux et quatre chevaux automobiles et motorisés. C'est sans doute à cette époque une des dernières compagnies hippomobiles de Paris en activité. Ce reportage sur les cochers de Paris a été commandé à Denise Colomb par Point de vue - Images du monde et est paru dans cette revue mondaine faite de papier glacé et de strass en 1954. L'inventaire en cours de ces négatifs comprend un peu plus de quarante clichés en relation avec ce reportage dont un bon tiers se passe dans une des ultimes écuries de Paris intra-muros. Nous n'en savons guère plus ; l'inventaire manuscrit de ces négatifs étant on ne peut plus laconique. Emmanuel Marguet et Florence Ertaud pour la MAP, avril 2020
#Culturecheznous
Jean Pottier, quartier de la Villeneuve
Le quartier de la Villeneuve à Grenoble en 1974
Né en 1932 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Jean Pottier suit une formation d'ingénieur qui l'amène à travailler dans l'industrie aéronautique à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Au milieu des années 1950,il commence à photographier son environnement. L'une de ses premières séries est consacrée aux habitats insalubres du bidonville de Nanterre dans lequel vivent encore, au milieu des années 1950, de nombreuses familles n'ayant pu être reloger après-guerre. Un ami lui permet de réaliser ses premières photographies pour le magazine Panorama Chrétien. Proche du mouvement des jeunesses ouvrières chrétiennes, Jean Pottier devient photo-journaliste pigiste. De 1957 à 2005, il est le photographe de nombreux journaux et magazines comme Panorama Chrétien, le Nouvel Observateur ou encore les revues de la CFDT. Au milieu des années 1960, il devient l'un des fondateurs de la section des photo-journalistes pigiste du même syndicat. Rapidement, les sujets sociaux et le monde du travail deviennent le cœur de son activité photographique. Proche des architectes et urbanistes Claude Parent et Paul Virilio, fondateurs du groupe Architecture Principe, son regard se porte alors sur la vie dans les grands ensembles qui se sont élevés à la périphérie des grandes villes pendant les Trente glorieuses. En 1974, à l’initiative de l’Ajibat, collectif de journalistes œuvrant sur les thématiques du logement, il se rend à Grenoble pour photographier le quartier de la Villeneuve conçu par Valère Novarina. Le nouvel ensemble d’immeubles se peuple peu à peu. Jean Pottier se fait ici l’observateur d’une vie qui se se construit portant son appareil sur les circulations dans la ville nouvelle ou sur les équipements (théâtre, médiathèque, crèche ou collège) qui permettent au fur et à mesure où les habitants s’approprient l’espace de faire vivre le lieu. Le radeau d’un enfant au milieu de ces immenses tours peut être lu comme le symbole d’une vie qui s’infiltre dans le béton des cités. Ce regard, plein d’espoir sur l’urbanisation française des années 1960-1970 sera largement tempéré par Jean Pottier au cours des années 1990-2000 et de ses dernières séries de photographies. Matthieu Rivallin, avril 2020.
#Culturecheznous
Marie, veuve de Romain Rolland, sur la terrasse de leur maison à Vezelay
Éliane Janet-Le Caisne à Vézelay en mai 1959 photographie Marie, veuve de Romain Rolland, sur la terrasse de leur maison à Vezelay qui deviendra le musée Zervos en 1965
Cette photographie d'Éliane Janet-Le Caisne prise en mai 1959, représente Marie, veuve de Romain Rolland (1866-1944), qui caresse son chien sur la terrasse de leur maison, qui deviendra le musée Zervos en 1965. Or, cette maison a une histoire, qui est contée dans le Journal de Vézelay 1938-1944, publié aux éditions Bartillat. C'est une partie du journal intime que Romain Rolland a tenu à la fin de sa vie. En 1938, il est un auteur mondialement célèbre, à la fois pour son œuvre (prix Nobel de littérature de 1915), et pour ses engagements pacifistes et antifascistes. Installé en Suisse depuis 1922, miné par des problèmes de santé, il décide de revenir dans le Morvan et de s'installer à Vézelay pour finir sa vie en son pays natal, précisément dans cette maison dont nous apercevons la terrasse et la vue. Le journal intime en question couvre les six dernières années de son existence: celles-ci conduisent d'abord à la seconde guerre mondiale, avec bruits de bottes et accords de Munich ; puis, vient la drôle de guerre et l'exode ; enfin, ce sont les années de l'occupation et du développement de la guerre sur les fronts britanniques et russes. Ce journal nous permet de vivre la succession des événements sur plusieurs plans. Sur un plan politique, l'écrivain procède à une analyse fine des faits, nous faisant partager ses points de vue et convictions. Comme il est toujours une personnalité qui compte dans le monde intellectuel de son temps malgré son isolement relatif, on assiste aux querelles et aux combats, quelquefois douteux, des savants et lettrés de l'époque. Deux de ses amitiés dominent le journal : en premier lieu, sa relation avec Paul Claudel (1868-1955), avec lequel il renoue par l'intermédiaire de son épouse (ici photographiée) après des décennies de fâcherie ; ce dernier essaie avec exaltation de convertir Romain Rolland et sa femme au catholicisme. Est également décrite l'amitié qu'il conservera presque jusqu'à la fin de sa vie pour Alphonse de Châteaubriant (1877-1951), auteur renommé devenu admirateur du Führer, qui collabora éhontément avec le pouvoir nazi à Paris et Berlin. Le journal narre également les vicissitudes de ces temps sombres, aussi bien sur un plan local que national. Il y évoque les hordes de Parisiens et de notables locaux sur les routes au moment de l'exode et de la défaite, les institutions publiques abandonnées (lieux de pouvoir mais aussi hôpitaux), les affres du rationnement et de la pénurie, tant à Vézelay qu'à Paris, les difficultés pour se déplacer (laissez-passer, rareté du carburant), les réquisitions allemandes de biens et de logement (Vézelay est un lieu de cantonnement pour les troupes allemandes au repos) , les fortunes rapides de certains à Vézelay, les résistances politiques (Maurice Brulfer) puis citoyennes à l'occupation, devenue de plus en plus brutale avec le temps. Enfin, cela reste le journal intime d'un grand écrivain, qui nous permet d'entrer dans son intimité familiale, amicale - il reçoit beaucoup de visites - et intérieure, faite de doutes, de questionnements incessants, de joies et de souffrances. Emmanuel Marguet, avril 2020
#Culturecheznous
Une chapelle néo-gothique à Carthage
La chapelle Saint Louis à Carthage, Tunisie, 1882
En 1830, année de la conquête de l’Algérie, le bey de Tunis Husseyn II (1784-1835) offre un terrain à Charles X. Il se trouve à Carthage où saint Louis avait trouvé la mort en 1270 lors de la huitième croisade. Comme le lieu précis de cet événement est inconnu, Jules de Lesseps (1809-1887), le fils du consul général de France en Tunisie Matthieu de Lesseps (1777-1832), choisit finalement sur la colline de Byrsa le lieu d’implantation d’une future chapelle. La construction de cet édifice, conçu d’après les plans de l’architecte Germain, démarre en 1841 sur la colline rebaptisée en l’honneur du nouveau souverain « Mont Louis-Philippe », pour s’achever quatre ans plus tard. C’est un monument de taille modeste qui s’inspire de la chapelle royale de Dreux, la nécropole de la Maison d’Orléans. Après plusieurs campagnes de restauration en 1875, 1910 et 1925, la chapelle Saint-Louis est fermée au public en 1943 puis démolie en 1950. Paul-Marie Famin, un photographe français installé à Alger, prend cette vue en 1882, soit un an après que la France a instauré un protectorat en Tunisie et deux ans avant la construction d’une cathédrale à proximité de la chapelle, la future cathédrale Saint-Louis. En arrière-plan, dans le long bâtiment à arcades se trouve le couvent des Pères blancs qui s’installent en Tunisie en 1875 sur ordre du cardinal Lavigerie (1825-1892), archevêque d’Alger et fondateur de cet ordre missionnaire, en tant que gardiens de la chapelle. C’est aujourd’hui le musée national de Carthage où le produit des fouilles archéologiques du site est conservé. À l’intérieur de la chapelle se trouvait une statue de saint Louis par Charles-Émile Seurre (1798-1858). Ferdinand de Lesseps, fils de Matthieu et donc frère de Jules, avait demandé au cardinal Lavigerie l'autorisation d'inhuler son père dans la chapelle, ce que le prélat lui accorda. Isabelle Gui, avril 2020
#Culturecheznous
Maison orientaliste Bonfils
Temple de Dakkeh, en Basse-Nubie, en Egypte, vers 1870
Prise entre 1867 et 1876 par Félix Bonfils (1831-1885), cette photo représente le temple de Dakkeh, en Basse-Nubie, en Egypte. Elle met en scène l'un des assistants du photographe, dans une pose pleine de bonhomie. Parmi les orientalistes, Bonfils se distingue en effet par l'humour qu'il instille dans ses compositions : quand il ne grime pas lui-même pour masquer des autoportraits, il met en scène ses assistants dans des poses nonchalantes qui tranchent avec la solennité des lieux. Au-delà de l'anecdote, ces assistants illustrent la circulation des pratiques photos des deux côtés de la Méditerrannée. Alors que les populations musulmanes et juives restent réservées quant à la photographie, les minorités chrétiennes s'y investissent. Le patriarche arménien de Jérusalem crée un véritable studio qui forme des séminaristes, dont l'un forme à son tour Abraham Guiragossian (1872-1955), assistant puis successeur des Bonfils. A l'inverse, un des assistants de Félix, Quayssar Hakim, le suit en France et à la mort de son employeur, installe définitivement son studio au Havre. Mathilde Falguière, avril 2020.
#Culturecheznous
Emile Zola allongé sur l’herbe en compagnie du chien Pinpin
Médan, septembre 1895
Cette image, prise à Médan en septembre 1895, montre Émile Zola couché sur le flanc, dans l’herbe, en compagnie d’un chien noir à la frimousse vive, éveillée. Dans le corpus des photos de Zola, cette scène champêtre tranche par deux éléments inhabituels : d’une part, la position allongée de l’écrivain, qui le met en quelque sorte au niveau de l’animal ; d’autre part, l’absence de ses emblématiques lorgnons, comme s’il avait voulu se dépouiller de son sérieux, de son « masque » d’intellectuel. Le chien, un loulou de Poméranie, est connu par d’autres photos et par la correspondance de l’auteur, qui l’avait baptisé Pinpin et lui donnait d’autres sobriquets affectueux ou comiques : « Monsieur Pin », ou « le chevalier Hector Pinpin de Coq-Hardi ». Le 18 juillet 1898, son combat en faveur de Dreyfus ayant entraîné sa condamnation par les assises de Versailles, Zola s’embarque précipitamment pour l’Angleterre afin d’échapper à la prison. Pinpin, se croyant abandonné par son maître, meurt de désespoir le 20 septembre 1898. Dans la correspondance « londonienne » entre Zola et sa femme Alexandrine, l’échange à propos de la maladie puis de la mort du petit chien s’étale sur cinq lettres – alors qu’on aurait pu imaginer l’écrivain totalement accaparé par la cause dreyfusarde et la tragédie de l’exil. En juillet 1899, soit quelques jours après son retour d’exil, Zola confie son chagrin dans une lettre envoyée à une rédactrice de L’Ami des bêtes, la première revue de défense des animaux qui avait été créée l'année précédente : « …puisque vous désirez quelques lignes de moi », écrit-il, « je veux vous dire qu’une des heures les plus cruelles, au milieu des heures abominables que je viens de passer, a été celle où j’ai appris la mort brusque, loin de moi, du petit compagnon fidèle qui, pendant neuf ans, ne m’avait jamais quitté. (…) Il m’a semblé que mon départ l’avait tué. J’en ai pleuré comme un enfant, j’en suis resté frissonnant d’angoisse, à ce point qu’il m’est impossible encore de songer à lui sans être ému. » Si Pinpin était son chien favori, Zola avait une passion pour toutes les bêtes en général, et il ne pouvait se passer de leur compagnie, ce que reflètent sa correspondance et les témoignages de ses amis. Même dans sa jeunesse précaire et bohème, il fut toujours entouré de chats, de chiens, d’oiseaux. Il eut une guenon, des serins, des perruches du Sénégal. L’une de ses joies les plus authentiques, quand les droits d’auteur de L’Assommoir lui permirent d’acheter la propriété de Médan, fut d’y aménager une véritable ferme : vaste volière avec diverses espèces de poules, cabanes à lapins, et surtout une étable de grand luxe – dallée, avec des mangeoires en marbre, et les noms des vaches gravés dans le mur ! Cet amour profond pour les animaux – allant bien au-delà d’un simple penchant « naturaliste » – est un aspect peu connu de la personnalité de Zola. « Pourquoi les bêtes, sont-elles toutes de ma famille, comme les hommes, autant que les hommes ? » Dans un article pour Le Figaro (1895), il définit la cause des bêtes comme « intimement liée à la cause des hommes [au point que] toute amélioration dans nos rapports avec l’animalité doit marquer à coup sûr un progrès dans le bonheur humain. Si tous les hommes doivent être heureux un jour sur la terre, soyez convaincus que toutes les bêtes seront heureuses avec eux. » Ces idées, assez largement répandues aujourd’hui, étaient révolutionnaires à l’époque où il les a exprimées. Sans faire de Zola un précurseur des animalistes, reconnaissons que certaines de ses réflexions anticipent la dimension éthique de leur combat. Par une extension logique de son humanisme fondamental, il s’érige en défenseur des animaux « au nom de la fraternité et de la justice », et leurs souffrances font vibrer en lui la même corde compassionnelle que les souffrances humaines, nées de la misère sociale décrite et dénoncée dans ses romans. Bruno Martin, chargé du fonds Zola à la MAP, 2019 Un sujet du journal d'Arte présente le fonds Zola à la MAP > https://www.arte.tv/fr/videos/103751-000-A/zola-son-talent-devoile-pour-la-photographie/

#Culturecheznous
Jacques-Henri Lartigue, la culture physique, 1922
1922 © J. H. Lartigue (c) Ministère de la Culture (France) / MAP-AAJHL
Jacques-Henri Lartigue, la culture physique, 1922 © J. H. Lartigue (c) Ministère de la Culture (France) / MAP-AAJHL Un homme légèrement vêtu et en bonne forme physique fait de l’exercice au jardin. Les petites haltères rondes et le lacet de sa tenue donnent à la scène une charmante atmosphère... La plaque de verre, stéréoscopique et autrefois regardée dans une visionneuse, offrait à l’esprit comme une fenêtre sur la nature et son relief. Jacques-Henri Lartigue (1894-1986), son auteur, particulièrement attentif à sa propre apparence, a réalisé de nombreuses photographies et toiles peintes représentant le corps en action. Ses images sont inspirées des revues sportives à la mode dont il était lecteur, et leur scénarisation à l’intérieur de ses albums évoque les mises en page de certains d’entre eux. Si l’on en croit le titre de la page de l’album où est collé un tirage réalisé d’après cette plaque, il est 10 h du matin, l’heure de « la culture physique » ! Nous sommes à Rouzat, en Auvergne, dans la propriété familiale des Lartigue qui disposait d’un court de tennis et d’une piscine propices à l’épanouissement des corps (et à la santé des esprits). Ici, c’est Robert Haguet, un cousin que Lartigue surnommait Ubu, qui est représenté. L’inscription en haut de la plaque, que l’on lirait un peu rapidement « coco », est en réalité le nombre 22, écrit à la verticale, qui désigne l’année de la prise de vue, 1922. Les images d’Ubu, sous presque tous les profils, viendront bientôt enrichir la plateforme POP et la sélection « gymnastique » de la base Mémoire dans laquelle les photographies de Roger Parry, Jean Pottier, André Kertész, Sénicourt, Marcel Bovis, Noël Le Boyer ou encore François Kollar, nous rappellent qu’à toutes les époques, si nous ne pouvons activer nos corps aussi librement que nous le souhaiterions, nos esprits ne doivent pas rester immobiles ! Juliette Dharmadhikari pour la MAP, mars 2020
#Culturecheznous
Régis Eyraud et le Touring Club de France
Le fonds photographique du Touring Club de France (TCF) est un « melting-pot » de photographes divers et variés. Certains noms n’apparaissent qu’une fois, avec des clichés qui se comptent sur les doigts d’une main. D’autres sont plus prolifiques, en production comme en sujets. Tel est le cas de Régis Eyraud dont la plupart des photos remontent aux années 1920-1930.
Si la vie de Régis Eyraud reste pour l'instant une énigme, sa production est assez importante pour un membre du TCF. Actuellement, les clichés inventoriés se concentrent sur la Côte d'Azur, la côte Atlantique (Loire-Atlantique, Finistère), et le Grand Est. Eyraud illustre majoritairement les paysages et le patrimoine urbain en des clichés épurés qui laisent peu de place à l'humain, ou alors sous forme de passant qui semble poser. D'autres clichés sont ouvertement plus curieux de l'activité hurmaine, mémorisant les processions de fêtes religieues, des scènes de marchés ou les premiers vacanciers sur les plages. Cette production a servi à illustrer quelques publications du TCF. L'auteur est, par exemple, l'unique photographe illustrateur des deux numéros de la série Sites et Monuments consacrés à l'Alsace (1929) et à la Lorraine (1937). Ici, la scène a été prise à Barr (Bas-Rhin), certainement de bon matin comme le laissent penser les rideaux baissés des devantures. Elle se situe au cœur de l’ancienne place du Marché-aux-Pommes-de-Terre, actuel croisement entre les rues du Collège et Taufflieb. Sur le cliché, la fontaine de 1873 occupe encore le centre de la place. Depuis, elle a été déplacée, engoncée dans le petit angle de rue qu’est devenue cette place. Deux chiens couchés attendent le retour de leur maître pour tirer la carriole chargée de pots à lait. Deux enfants et une femme regardent l’objectif, plus intrigués par le photographe que par cette livraison de lait d’un autre âge ; une livraison matinale comme nous n’en verrons plus et qui éveille un sourire de nostalgie… Fatima DE CASTRO pour la MAP Octobre 2020 RÉGIS EYRAUD SUR MÉMOIRE

#Culturecheznous
François le Diascorn en Amérique
L'œuvre photographique de François le Diascorn, qui a fait l'objet d'une donation à l'état, reflète ses nombreux voyages, notamment en Amérique. Le motif de la bannière étoilée se répète dans les clichés de voyage.
François Le Diascorn, qui a travaillé successivement pour les agences Viva et Rapho, fut un voyageur impénitent avant de devenir photographe. C’est durant un de ses voyages qu’il s’initia à ce qui allait devenir son métier et sa passion. Jeune globe-trotter, il était attiré par l’Orient – Égypte, Inde et Maroc – et ne fut amené à découvrir les États-Unis que par les hasards de la vie et, plus précisément, ceux nés d’une rencontre. En effet, c’est en Inde, en 1971, qu’il rencontra sa future épouse de nationalité Américaine : Nancy Guri Duncan. Cette dernière dit : « L’ouest ne lui avait jamais rien dit. Cette rencontre avec une américaine changea tout. François opéra une volte-face… dans ses objectifs1. » Il y fit son premier voyage et ses premières photographies dès 1973 alors qu’il travaillait pour une chaîne de télévision États-uniennes en Oregon, terre natale de sa compagne. L’Amérique devint tout de suite une des ses destinations fétiches et l’un des ses sujets favoris. La bannière étoilée, faite de 13 bandes représentant les colonies britanniques fondatrices de la fédération et des cinquante étoiles figurant le nombre d’états de l’union, est donc naturellement présente dans la photographie de François le Diascorn comme motif de l’identité, de la grandeur, de l’imaginaire et du rêve américain. Comme le dit très justement, le photographe : « le fil directeur dans Only in America est le côté excentrique et insolite de ce pays. De fait, il y a toujours dans les images quelque chose qui renvoie à l’Amérique : un signe, un vêtement, un drapeau...2 » En premier lieu, ce drapeau apparaît comme un emblème de grandeur, de puissance voire même de démesure. Le cliché pris à New-York en 2002 en est la parfaite illustration. La puissance économique de l’Amérique est figurée dans la fresque représentant un business sûr de sa force au milieu des buildings d’une avenue New-yorkaise. Le drapeau, ici, renforce cette impression en trônant de manière inébranlable dans le bleu de la fresque et du ciel. À nos yeux de français, cette bannière peut paraître à la fois insolite et irréelle. Cette symbolique de grandeur et de puissance qu’incarne le drapeau américain est donc devenue une image à part entière de l’identité de cette société toujours en marche, toujours à la recherche d’une nouvelle frontière3. L’allégorie du pionnier, pivot de l’imaginaire historique américain, allégorie sans cesse renouvelée à travers l’histoire de ce pays, se retrouve dans l'image capturée sur une plage de l’Oregon en 1976. Ici une jeune femme enveloppée dans la bannière étoilée suit deux auto-stoppeurs qui ont l’air de vouloir traverser l’océan, comme en quête d’une terre nouvelle évoquée ici par le rocher maritime Haystack rock que l’on voit à l’arrière-plan. Dans Only in America, toujours, François le Diascorn faite cette remarque très juste : « [Aux USA], il y a des groupes ethniques et culturels très différents, attachés à affirmer ou maintenir leur culture, mais ils ont tous quelque chose en commun, c’est d’être américain4. » Ces deux images mettent très bien en lumière cet aspect des choses. Une première image met en scène un drapeau américain sur lequel est figuré un amérindien. Celui-ci, bien qu’inversé, montre avec fierté l’identité aujourd’hui américaine du peuple Navajo d’Arizona sur fonds de grands paysages canyonesques. En outre, Page est le lieu du Navajo village center où les survivants de ce peuple autochtone essaie de maintenir leur culture… sur fonds de tourisme La seconde a été prise à l’occasion du Cheyenne Frontiers Days qui se tient tous les ans durant la dernière décade de juillet depuis 1897. Cet évènement est un des rodéos en plein air de cow-boys parmi les plus populaire du pays. Pourtant, notre photographe y a vu l’occasion de prendre ce cliché sur lequel de véritables cheyennes défilent en brandissant dignement la bannière étoilée, invités qu’ils sont à participer à ces festivités depuis 1898. Parmi les autres usages symboliques de la bannière étoilée saisis par l’objectif de François le Diascorn, se trouve en bonne place les utilisations qui en sont faites dans ses expressions politiques. Un premier cliché saisit un moment de la convention démocrate de 1976 qui verra gagner Jimmy Carter, en plein moment de disgrâce pour Nixon. Celle-ci s’est déroulée au Madison Square Garden de New-York en juillet 1976. Les deux protagonistes de cette photographie peuvent aussi bien être des démocrates que des opposants républicains cherchant à ridiculiser le sus-cité candidat, ce qui symbolise un pilier de l’identité américaine : la liberté d’expression que la cour suprême a toujours défendue bien que toute utilisation jugée dégradante de la bannière étoilée est formellement interdite par la loi. Une seconde image, qui figure un opposant à la guerre du Vietnam, reflète tout à fait les mêmes idées. L’ultime série dans laquelle apparaît la bannière étoilée comme motif photographique est celle des commémorations et fêtes. Nous y voyons l’un des porte-drapeaux du défilé du Veteran’s Day commémoré tous les 11 novembre depuis la fin de première guerre mondiale qui, bien qu’il tourne la tête vers l’objectif, n’en garde pas moins une certaine gravité solennelle. Ce fut certainement l’occasion pour notre photographe de saisir le drapeau américain comme un emblème patriotique brandi fièrement lors de certains évènements patriotiques, les défilés à vocation historique ou militaire en faisant partie. Sur cette photo de train fantôme prise à la fête foraine de Pueblo en 1976, la bannière étoilée ne se révèle qu’en filigrane à l’endroit des trois étoiles peintes sur le fond bleu de la voiture de manège. Pourtant, à mes yeux, celles-ci sont comme l’expression de l’américanisation définitive de la grande figure du roman gothique anglais qu’est Frankenstein via ce que l’on appelle aujourd’hui paresseusement l'entertainment incarnée par la suprématie de l’imaginaire du cinéma américain et la figure inoubliable de Boris Karloff. En somme, François Le Diascorn qui définit sa photographie « américaine » comme celle de l’Amérique horizontale plutôt que verticale5 utilise souvent la bannière étoilée comme un leitmotiv vertical de cette Amérique horizontale. 1 : Only in America, [photographies de] François Le Diascorn ; textes de François Le Diascorn et de Nancy J. Guri Duncan, [Grâne] : Créaphis éd., impr. 2010, p. 99. 2 : op.cit, p. 104 3 : op.cit, p. 104 4 : op.cit, p.105 5 : op.cit, p.105 Emmanuel Marguet pour la MAP Décembre 2020

#Culturecheznous
Louis Moreau à l'hôtel d'Essling
Cette photo montre le décor de glaces et de boiseries sculptées du grand salon de l’hôtel d’Essling, à Paris, rue Jean-Goujon, avant les profondes transformations qui ont affecté cette demeure, construite vers 1866 pour la Duchesse de Rivoli, princesse d’Essling. La prise de vue est donc antérieure à 1919, date à laquelle l’hôtel fut cédé à la société anonyme « Maison des Centraliens » qui la restructura de fond en comble. Les locaux abritent aujourd’hui également un hôtel de luxe.
L’auteur de la photo est Louis Moreau, un photographe ayant exercé de 1890 à 1930 environ, avant de vendre son fonds de négatifs aux Archives photographiques à une date incertaine (peut-être 1951). Nous ne savons encore que très peu de choses sur Louis Moreau : l’adresse de son studio, rue de Tournon à Paris, sa spécialité : photographe d’art, mais ses dates de naissance et de mort nous sont inconnues. A-t-on au moins un portrait de lui ? Aucun, à part l’autoportrait indirect, involontaire peut-être, qui se dessine sur cette image : à côté de la grande chambre sur pied (où l’on pouvait glisser des plaques 24x30, le format favori de notre photographe), on distingue sa silhouette floue, ses traits brouillés, indistincts, vision attirante et mystérieuse, mais frustrante, parce qu’à travers elle, nous ne pouvons toujours pas associer un visage à son nom. Ce fantôme placé dans un jeu de miroirs apparaît néanmoins comme l’intermédiaire d’une magie : la glace photographiée reflète le mur qui lui fait face, où s’ouvre une porte vers une autre pièce, elle-même ouverte sur une autre pièce, ou fermée par une autre glace, ce n’est pas clair – et nous nous perdons dans cette « mise en abyme » qui nous entraîne dans une enfilade d’échos visuels, un tunnel vers l’infini… Bruno Martin, novembre 2020 LE FONDS MOREAU SUR POP

#Culturecheznous
Le Touring club au Vietnam
Si la majorité du fonds du Touring Club se consacre aux patrimoines français, ce dernier ne se cantonne toutefois pas à la métropole. Au début du 20e siècle, la France s’étend en colonies africaines et asiatiques ; le Touring club suit.
Un nombre impressionnant de comités est créé par le Touring Club de France dès sa mise en place pour offrir une couverture thématique apte à répondre aux spécificités du tourisme : comité du tourisme nautique (1904), du tourisme hivernal (1907), du tourisme de montagne (1908), du tourisme de camping (1912). Les territoires extra-métropolitains ne sont pas oubliés. En 1909 est créé le Comité du tourisme colonial, dont la genèse est relatée dans la Revue mensuelle du Touring-club de France de novembre 1909. Le rapport annuel paru dans le numéro de décembre 1909 justifie cette création par l’oubli dont ont été victimes les colonies, en particulier « cette admirable Indo-Chine, où l’art et la culture se disputent l’intérêt du voyageur, un art d’une ancienneté qui remonte aux premiers âges du monde, une nature exubérante et dont la jeunesse semble défier le temps ». À cette image d’Épinal fait suite un état d’esprit bien dans son temps : « C’est par le voyageur que les conquêtes se préparent et s’affirment. Envoyer des Français voyager en ces nouvelles Frances, c’est en prendre une possession plus profonde, plus intime, c’est les faire nôtres définitivement […] ». La première séance de travail du comité se tient le 6 novembre 1909 et détermine les grandes lignes d’action du TCF dans les colonies. Une première brochure paraît (1910 ?), intitulée L’Indo-Chine française : sites, monuments, types, forêts vierges ; puis un guide, simplement intitulé Indo-Chine, la même année. Ce dernier présente les moyens de transports disponibles (voies maritimes et fluviales, chemin de fer, routes), les hébergements, un historique illustré de sites remarquables. Comme toujours, les clichés proviennent de membres, comme celui présenté ici, pris par Charles Lemire, visible à la dernière page du guide et ayant servi à illustrer une conférence du TCF (conférence n° 22). Charles Lemire (1839-1912), commis des Postes en charge de l’installation de lignes télégraphiques dans les possessions françaises, profite de ses multiples chantiers pour explorer les régions où il se trouve : Tonkin, Cambodge, Nouvelle-Calédonie. De 1886 à 1894, il part en Indochine en tant qu’administrateur colonial. De ce séjour, il tire des conférences une fois revenu en métropole ainsi que des publications (L’Indochine, 1884 ; Le Peuplement de nos colonies, 1896 ; Les Cinq pays de l’Indochine française, 1899). Détouré à la gouache pour mettre en valeur la toiture, comme le montre la plaque de verre négative, ce cliché présente une maison traditionnelle de l’ethnie matriarcale Edé, installée sur les plateaux du centre Vietnam (ex. Tonkin). Sur pilotis, réalisées en bois, bambou, canne et rotin, ces maisons se divisent intérieurement en deux parties : le gah, espace pour la communauté et les invités ; l’ôk, espace dédié aux chambres, avec une cuisine. Le vide aménagé sous les pilotis est réservé au stockage et au bétail. Ces maisons regroupent une famille autour de la Khua sang, la femme la plus âgée qui dirige les affaires communes et résout les différents au sein du clan. Loin d’être figée, la bâtisse s’agrandit au fur et à mesure qu’une femme se marie, pouvant s’étendre jusqu’à cent mètres. Encore présentes aujourd’hui, ces constructions traditionnelles, dont la charpente en bateau renversé rappellerait l’origine maritime de l’ethnie Edé, tendent à disparaître pour laisser place à l’uniformisation contemporaine. Outre son aspect ethnologique, ce négatif de Lemire est également intéressant comme illustration des usages faits par le TCF des photographies qu’il recevait, ici la projection et la publication. Fatima de Castro pour la MAP Novembre 2020 LE VIETNAM VIA LE TCF SUR POP TOUT LE FONDS TCF SUR POP

#Culturecheznous
Les enfants de Jules Antoine
Architecte voyer à la Ville de Paris, Jules Antoine (1863-1948) découvre la photographie dans le milieu des années 1890. Amateurs de patrimoine prestigieux, s’abstenir : tout architecte qu’il est, Jules Antoine réserve ses plaques aux petits bonheurs familiaux, à commencer par ceux que lui procurent ses enfants, Jean et Marthe, nés dans les premières années de la décennie.
Parcourir le fonds Jules Antoine, c’est aller de jardins en ateliers, de parties de pêche en parties de luge, de mascarades en fenaisons. On fait connaissance, autour de Jules et de Pauline, sa femme, d’un petit groupe de proches dont les noms ne nous sont pas tous parvenus. Leurs enfants jouent avec Jean et Marthe, tout ce petit monde grandit, et les regards les plus perspicaces pourront bientôt s’adonner sans modération au jeu des ressemblances pour compléter quelques légendes, puisque ce joli fonds fera très prochainement son entrée sur POP. En avant-première, un portrait de Marthe et Jean qui a certainement fait pester leur photographe de père. C’est déjà bien assez compliqué d’attendre que la pluie s’arrête pour les asseoir côte à côte sur le petit balcon, sans gigoter, si possible, et sans faire de grimaces… Jean, tout en malice, glisse un mot à l’oreille de sa sœur qui part en rigolade juste au moment fatidique. Et voilà, encore une plaque fichue ! Quoique. Un bon siècle plus tard, l’espièglerie, la complicité et le rire sont toujours là, qui réveillent nos sourires. Elle est pas belle, la vie ? Anne Cook pour la MAP Novembre 2020 LE FONDS JULES ANTOINE SUR POP