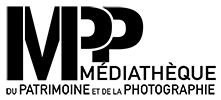#CultureChezNous
Retrouvez ici toutes les actualités de la rubrique #CultureChezNous.
Les objets
#Culturecheznous
François le Diascorn en Amérique
L'œuvre photographique de François le Diascorn, qui a fait l'objet d'une donation à l'état, reflète ses nombreux voyages, notamment en Amérique. Le motif de la bannière étoilée se répète dans les clichés de voyage.
François Le Diascorn, qui a travaillé successivement pour les agences Viva et Rapho, fut un voyageur impénitent avant de devenir photographe. C’est durant un de ses voyages qu’il s’initia à ce qui allait devenir son métier et sa passion. Jeune globe-trotter, il était attiré par l’Orient – Égypte, Inde et Maroc – et ne fut amené à découvrir les États-Unis que par les hasards de la vie et, plus précisément, ceux nés d’une rencontre. En effet, c’est en Inde, en 1971, qu’il rencontra sa future épouse de nationalité Américaine : Nancy Guri Duncan. Cette dernière dit : « L’ouest ne lui avait jamais rien dit. Cette rencontre avec une américaine changea tout. François opéra une volte-face… dans ses objectifs1. » Il y fit son premier voyage et ses premières photographies dès 1973 alors qu’il travaillait pour une chaîne de télévision États-uniennes en Oregon, terre natale de sa compagne. L’Amérique devint tout de suite une des ses destinations fétiches et l’un des ses sujets favoris. La bannière étoilée, faite de 13 bandes représentant les colonies britanniques fondatrices de la fédération et des cinquante étoiles figurant le nombre d’états de l’union, est donc naturellement présente dans la photographie de François le Diascorn comme motif de l’identité, de la grandeur, de l’imaginaire et du rêve américain. Comme le dit très justement, le photographe : « le fil directeur dans Only in America est le côté excentrique et insolite de ce pays. De fait, il y a toujours dans les images quelque chose qui renvoie à l’Amérique : un signe, un vêtement, un drapeau...2 » En premier lieu, ce drapeau apparaît comme un emblème de grandeur, de puissance voire même de démesure. Le cliché pris à New-York en 2002 en est la parfaite illustration. La puissance économique de l’Amérique est figurée dans la fresque représentant un business sûr de sa force au milieu des buildings d’une avenue New-yorkaise. Le drapeau, ici, renforce cette impression en trônant de manière inébranlable dans le bleu de la fresque et du ciel. À nos yeux de français, cette bannière peut paraître à la fois insolite et irréelle. Cette symbolique de grandeur et de puissance qu’incarne le drapeau américain est donc devenue une image à part entière de l’identité de cette société toujours en marche, toujours à la recherche d’une nouvelle frontière3. L’allégorie du pionnier, pivot de l’imaginaire historique américain, allégorie sans cesse renouvelée à travers l’histoire de ce pays, se retrouve dans l'image capturée sur une plage de l’Oregon en 1976. Ici une jeune femme enveloppée dans la bannière étoilée suit deux auto-stoppeurs qui ont l’air de vouloir traverser l’océan, comme en quête d’une terre nouvelle évoquée ici par le rocher maritime Haystack rock que l’on voit à l’arrière-plan. Dans Only in America, toujours, François le Diascorn faite cette remarque très juste : « [Aux USA], il y a des groupes ethniques et culturels très différents, attachés à affirmer ou maintenir leur culture, mais ils ont tous quelque chose en commun, c’est d’être américain4. » Ces deux images mettent très bien en lumière cet aspect des choses. Une première image met en scène un drapeau américain sur lequel est figuré un amérindien. Celui-ci, bien qu’inversé, montre avec fierté l’identité aujourd’hui américaine du peuple Navajo d’Arizona sur fonds de grands paysages canyonesques. En outre, Page est le lieu du Navajo village center où les survivants de ce peuple autochtone essaie de maintenir leur culture… sur fonds de tourisme La seconde a été prise à l’occasion du Cheyenne Frontiers Days qui se tient tous les ans durant la dernière décade de juillet depuis 1897. Cet évènement est un des rodéos en plein air de cow-boys parmi les plus populaire du pays. Pourtant, notre photographe y a vu l’occasion de prendre ce cliché sur lequel de véritables cheyennes défilent en brandissant dignement la bannière étoilée, invités qu’ils sont à participer à ces festivités depuis 1898. Parmi les autres usages symboliques de la bannière étoilée saisis par l’objectif de François le Diascorn, se trouve en bonne place les utilisations qui en sont faites dans ses expressions politiques. Un premier cliché saisit un moment de la convention démocrate de 1976 qui verra gagner Jimmy Carter, en plein moment de disgrâce pour Nixon. Celle-ci s’est déroulée au Madison Square Garden de New-York en juillet 1976. Les deux protagonistes de cette photographie peuvent aussi bien être des démocrates que des opposants républicains cherchant à ridiculiser le sus-cité candidat, ce qui symbolise un pilier de l’identité américaine : la liberté d’expression que la cour suprême a toujours défendue bien que toute utilisation jugée dégradante de la bannière étoilée est formellement interdite par la loi. Une seconde image, qui figure un opposant à la guerre du Vietnam, reflète tout à fait les mêmes idées. L’ultime série dans laquelle apparaît la bannière étoilée comme motif photographique est celle des commémorations et fêtes. Nous y voyons l’un des porte-drapeaux du défilé du Veteran’s Day commémoré tous les 11 novembre depuis la fin de première guerre mondiale qui, bien qu’il tourne la tête vers l’objectif, n’en garde pas moins une certaine gravité solennelle. Ce fut certainement l’occasion pour notre photographe de saisir le drapeau américain comme un emblème patriotique brandi fièrement lors de certains évènements patriotiques, les défilés à vocation historique ou militaire en faisant partie. Sur cette photo de train fantôme prise à la fête foraine de Pueblo en 1976, la bannière étoilée ne se révèle qu’en filigrane à l’endroit des trois étoiles peintes sur le fond bleu de la voiture de manège. Pourtant, à mes yeux, celles-ci sont comme l’expression de l’américanisation définitive de la grande figure du roman gothique anglais qu’est Frankenstein via ce que l’on appelle aujourd’hui paresseusement l'entertainment incarnée par la suprématie de l’imaginaire du cinéma américain et la figure inoubliable de Boris Karloff. En somme, François Le Diascorn qui définit sa photographie « américaine » comme celle de l’Amérique horizontale plutôt que verticale5 utilise souvent la bannière étoilée comme un leitmotiv vertical de cette Amérique horizontale. 1 : Only in America, [photographies de] François Le Diascorn ; textes de François Le Diascorn et de Nancy J. Guri Duncan, [Grâne] : Créaphis éd., impr. 2010, p. 99. 2 : op.cit, p. 104 3 : op.cit, p. 104 4 : op.cit, p.105 5 : op.cit, p.105 Emmanuel Marguet pour la MAP Décembre 2020

#Culturecheznous
Régis Eyraud et le Touring Club de France
Le fonds photographique du Touring Club de France (TCF) est un « melting-pot » de photographes divers et variés. Certains noms n’apparaissent qu’une fois, avec des clichés qui se comptent sur les doigts d’une main. D’autres sont plus prolifiques, en production comme en sujets. Tel est le cas de Régis Eyraud dont la plupart des photos remontent aux années 1920-1930.
Si la vie de Régis Eyraud reste pour l'instant une énigme, sa production est assez importante pour un membre du TCF. Actuellement, les clichés inventoriés se concentrent sur la Côte d'Azur, la côte Atlantique (Loire-Atlantique, Finistère), et le Grand Est. Eyraud illustre majoritairement les paysages et le patrimoine urbain en des clichés épurés qui laisent peu de place à l'humain, ou alors sous forme de passant qui semble poser. D'autres clichés sont ouvertement plus curieux de l'activité hurmaine, mémorisant les processions de fêtes religieues, des scènes de marchés ou les premiers vacanciers sur les plages. Cette production a servi à illustrer quelques publications du TCF. L'auteur est, par exemple, l'unique photographe illustrateur des deux numéros de la série Sites et Monuments consacrés à l'Alsace (1929) et à la Lorraine (1937). Ici, la scène a été prise à Barr (Bas-Rhin), certainement de bon matin comme le laissent penser les rideaux baissés des devantures. Elle se situe au cœur de l’ancienne place du Marché-aux-Pommes-de-Terre, actuel croisement entre les rues du Collège et Taufflieb. Sur le cliché, la fontaine de 1873 occupe encore le centre de la place. Depuis, elle a été déplacée, engoncée dans le petit angle de rue qu’est devenue cette place. Deux chiens couchés attendent le retour de leur maître pour tirer la carriole chargée de pots à lait. Deux enfants et une femme regardent l’objectif, plus intrigués par le photographe que par cette livraison de lait d’un autre âge ; une livraison matinale comme nous n’en verrons plus et qui éveille un sourire de nostalgie… Fatima DE CASTRO pour la MAP Octobre 2020 RÉGIS EYRAUD SUR MÉMOIRE

#Culturecheznous
Willy Ronis, La chaussure nationale, usine Pillot, Paris, 1946. © Donation Willy Ronis, ministère de la culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion GrandPalaisRmn Photo
Commande du périodique La Française, Paris, 1946
Au sortir de la seconde guerre mondiale et en réponse aux crises d’approvisionnement qui perdurent, l’État encadre la production de biens de première nécessité. Ces mesures reprennent de précédentes décisions prises lors de la première guerre mondiale par Étienne Clémentel, ministre de l’Économie et de l’Industrie. « La chaussure nationale » dite les « clémentelles », « le costume national », autant de de productions accompagnées afin de répondre aux fortes tensions entre un tissu industriel désorganisé et l’assouvissement de besoins primaires. Ces nécessités « populaires » ne sont certes pas vitales, leur réponse permet d’assurer un relatif équilibre social. Par son intervention économique, l’État organise la production industrielle et la rationalise. Comme toujours lors de pareils cas, les mots clés sont réappropriation de l’industrie nationale, production de masse, diffusion et prix raisonnables – le président Macron parle de solidarité et de souveraineté. Situation que nous ne connaissons pas aujourd’hui – ou pas encore –, l’inflation alourdit alors considérablement la vie : d’août 1944 à décembre 1947, les prix sont multipliés par 4,5 soit une progression moyenne de + 56 % par an ! L’État assure les équilibres. Après des années difficiles durant la guerre sur le littoral méditerranéen, Willy Ronis reprend en 1945 son métier de photographe indépendant. Illustrateur-reporter, il répond ici à une commande du périodique La Française, le journal de progrès féminin. La société Pillot est localisée au 126 boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement ; Willy Ronis habite chez sa mère au 117 boulevard Richard-Lenoir, c’est donc en voisin qu’il se rend dans cette très petite industrie urbaine. L’ouvrière occupe pleinement le cadre, tout autant que son outil de fabrication et le produit manufacturé. Deux autres ouvrières en arrière-plan suggèrent des locaux de petite dimension éclairés à la lumière naturelle. Chez Ronis, les années 1945-1954 – date de son départ de l’agence Rapho – sont « humanistes », qualificatif tardivement accolé à la photographie de Willy Ronis. Il travaille pour la presse engagée de gauche et se tisse un réseau rémunérateur de clients industriels, particulièrement en Alsace. La France se redresse ; les Français sont acteurs du redressement. À partir de la fin des années 1950, les photographies industrielles de Willy Ronis se déshumanisent. La mécanisation, l’automatisation, le rendement à moindre personnel s’accompagnent chez lui d’une photographie appliquée et technique, d’effets de laboratoire surprenants et passés de mode. En 1950, il défend pourtant ses convictions professionnelles à l’entreprise de constructions mécaniques Crétin : « Je m’attache à inclure dans mes prises de vues le caractère humain que recèle tout travail, même le plus hautement mécanisé, et cela par le choix du geste et de l’attitude [...], par un souci de vie ». Lors de sa consécration à partir des années 1980, Willy Ronis ressassera à l’envi son intérêt pour l’homme et pour la vie, sélectionnant dans ses archives les photographies qui répondent à cette attente, comme celle-ci, pour le livre de Gilles Mora et l’exposition qui l’accompagne, Le Dur labeur, Arles, Actes Sud, 2007. Ronan Guinée, avril 2020.