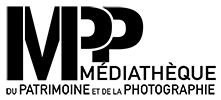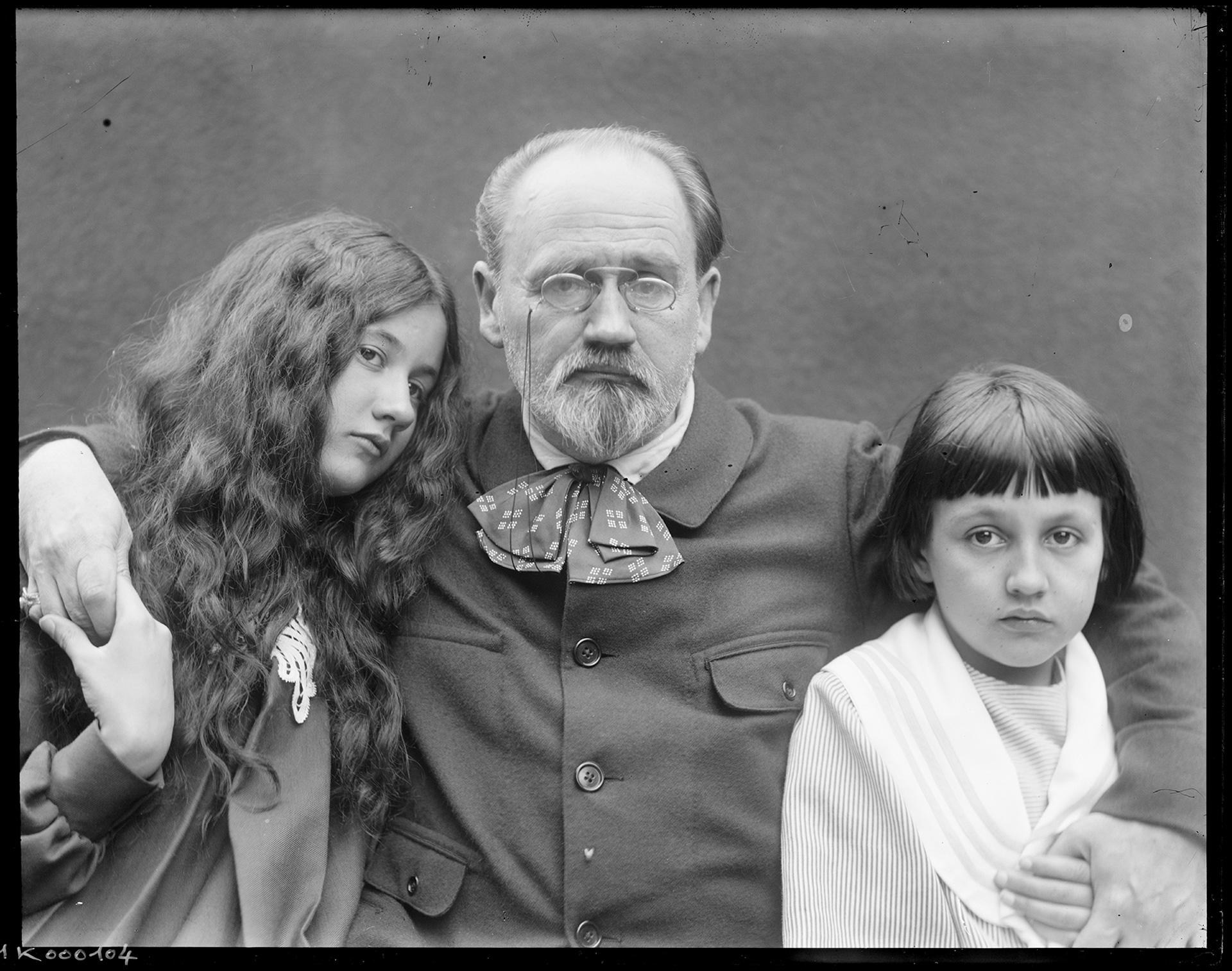Contenus associés
Versement, Émile Zola
L'ensemble du fonds Emile Zola désormais en ligne sur Mémoire
Gérard Uféras, La grâce et le feu
aux éditions Kulturalis

Glyndebourne, 1991
© Gérard Uféras
Michael Kenna, Haïkus d’argent
Aux éditions Skira

Dakekanba and Snow Barriers, Hokkaido, Japan. 2020
© Donation Michael Kenna, MPP, DR.